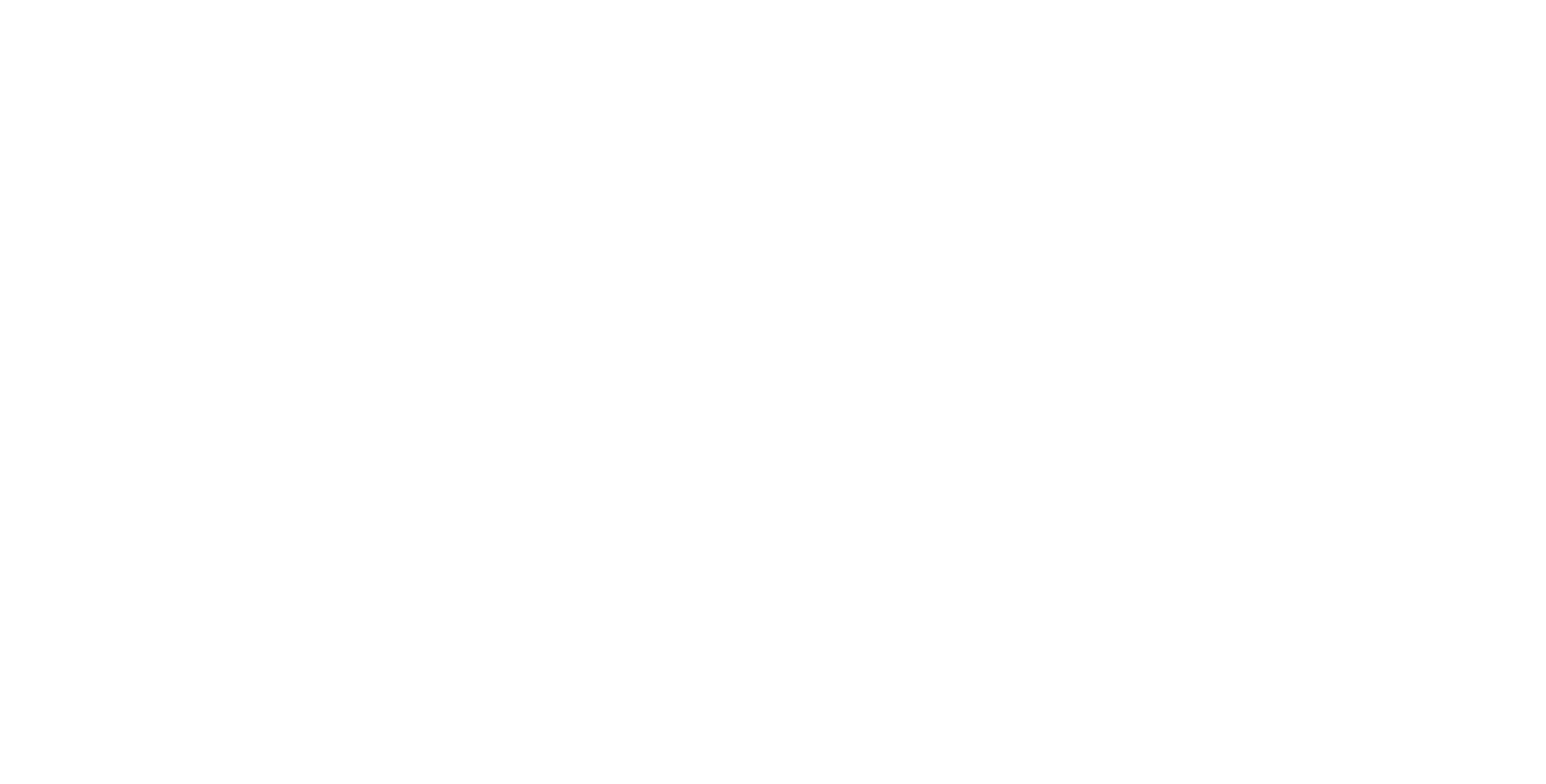
Les enjeux du dérèglement climatique sont aujourd’hui largement connus et médiatisés, et nous en faisons depuis plusieurs années l’expérience avec des épisodes de sécheresses, de fortes chaleurs, d’inondations et d’évènements climatiques autrefois rares qui s’intensifient.
Le secteur de la construction est responsable de 40 % des émissions de gaz à effet de serre1 : 30 % de ces émissions sont attribuables à la phase de construction du bâti (extraction de matière, logistique, chantier), et 70 % à son usage (chauffage, éclairage, maintenance)2.
La consommation d’énergie liée à l’usage du bâtiment est composée de systèmes techniques variés, notamment :
- le chauffage ;
- la climatisation ;
- l’éclairage artificiel ;
- la ventilation mécanique ;
- les équipements électriques ;
- et la production d’eau chaude.
Ces machines sont les résultats d’innovations rendues possibles en grande partie par l’extraction et l’utilisation des énergies fossiles et nécessitent toutes de l’énergie pour fonctionner. Elles constituent un écosystème dont nous dépendons pour moduler le confort intérieur de nos bâtiments. Néanmoins, comme tout objet technique, elles comportent des inconvénients en contrepartie des bénéfices qu’elles produisent, parmi lesquels :
- leur consommation d’énergie ;
- la dépendance à des matières rares et lointaines ;
- l’incertaine disponibilité de leurs composants pour leur réparation future ;
- l’effort de maintenance par une main d’œuvre qualifiée ;
- et le verrou contractuel, assurantiel et technique de l’exploitation qui leur est associé.
En outre, l’énergie tend aujourd’hui à se raréfier à la fois par une baisse de consommation des énergies fossiles, par l’intermittence des énergies renouvelables et décarbonées qui viendront les remplacer, et par un contexte global incertain. Réduire la demande en énergie des bâtiments est donc nécessaire pour éviter de dépendre d’une énergie rare et de plus en plus coûteuse, et agir dans le même temps pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre.
Paradoxalement, ce sont ces mêmes dispositifs techniques complexes qui sont aujourd’hui pressentis pour répondre aux enjeux actuels du réchauffement climatique.
Dans ce contexte, nous avons en tant qu’architectes et concepteur·ices de bâtiments — neufs ou réhabilités — une responsabilité à prendre pour opérer des changements radicaux et sauvegarder autant que possible l’héritage construit que nous laisserons aux générations futures.
À rebours des solutions techniques actuellement mises en oeuvre, nous estimons qu’il est urgent de ré-actualiser des principes plus anciens de conception architecturale. Nous formulons ainsi l’hypothèse que des bâtiments réellement résilients seraient des bâtiments comportant un minimum de machines, où les usagèr·es auraient le savoir et la capacité de moduler les conditions environnementales par elleux-mêmes. Cette réflexion s’inscrit logiquement en continuité avec les travaux sur le bioclimatisme en architecture — théorisés au milieu du 20ème siècle par des architectes comme Víctor Olgyay — mais existant depuis l’émergence d’une architecture vernaculaire imaginée et construite en relation avec les conditions environnementales locales.
Dans notre pratique de maîtrise d’œuvre, nous sommes forcé·es de constater que certains principes du bioclimatisme — l’étude approfondie du climat local, l’orientation du bâti, le recours à la ventilation naturelle, l’expérimentation de low-techs, la conception de et avec l’environnement direct, la participation active des habitant·es — sont généralement considérés comme des pratiques incapables de maintenir un niveau de confort comparable à l’installation de machines réputées fournir un confort invariable et simple d’usage.
Pourtant, lorsque nous avons commencé à enquêter sur ces dispositifs techniques dans des bâtiments récemment livrés, nous nous sommes confrontés à des avis discordants sur l’efficacité des machines :
- Les systèmes de ventilation mécanique sont généralement éteints car jugés inconfortables (bruit, sensation de courant d’air, sécheresse de l’air) ;
- Les pièces de rechange ne sont plus disponibles pour réparer un dispositif, rendant l’installation obsolète bien avant la fin de vie du bâtiment ;
- Le bâtiment est rendu très étanche, entraînant, en cas d’arrêt de la ventilation ou de coupure d’électricité, des problèmes de condensation et d’humidité qui dégradent prématurément les matériaux ;
- Les systèmes de chauffage ou de rafraîchissement deviennent inopérants en cas de coupure d’électricité, rendant les espaces inhabitables sans solution de secours ;
- Les interfaces de pilotage sont souvent trop complexes, rendant les habitant·es dépendant·es d’experts ou de techniciens pour tout ajustement ;
- Les algorithmes de régulation ne correspondent pas aux usages réels des occupant·es et imposent des comportements standardisés ;
- Le coût d’entretien et de maintenance est sous-évalué, entraînant des charges financières imprévues pour les usagèr·es ;
- Les équipements connectés génèrent une collecte de données personnelles, soulevant des questions sur la vie privée et le contrôle des usages ;
- La dépendance aux fabricants et aux contrats de maintenance verrouille les usagèr·es dans des logiques propriétaires où toute modification devient difficile voire impossible ;
- Certains systèmes, sous prétexte d’optimisation énergétique, limitent les capacités d’adaptation spontanée (ex. : fenêtres condamnées pour ne pas perturber les flux d’air mécanisés) ;
- La superposition de normes et de certifications techniques favorise des solutions industrielles standardisées, au détriment de solutions adaptées au contexte local.
Le mythe d’une architecture automatique — qui veillerait sur notre bien-être par des capteurs et des algorithmes parfaitement adaptés à nos sensations — nous vient directement de la pensée cybernétique. Contrairement aux promesses optimistes de ce courant de pensée, il nous faut enfin admettre que l’informatisation et la délégation du contrôle environnemental aux machines n’aboutissent pas à un confort amélioré, mais plutôt à un renforcement du contrôle exercé par les machines sur nos corps. C’est à nous d’entrer dans les réglages par défaut d’un ensemble de dispositifs qui demandent une attention permanente : maintenance, disponibilité énergétique, mises à jour, remplacement, etc.
Dans “Énergie et équité”, Ivan Illich met en lumière le paradoxe inhérent à l’accélération des moyens de transport. Il expose ainsi le fait que la dépendance croissante aux infrastructures et aux technologies de transport finit par restreindre la mobilité réelle des usagers, tout en accroissant leur soumission à un système technique imposé. Il écrit : “Passé un seuil critique, l’industrie du transport fait perdre plus de temps qu’elle n’en fait gagner. L’utilité marginale d’un accroissement de la vitesse de quelques-uns est acquise au prix de la désutilité marginale croissante de cette accélération pour la majorité”3.
Il est possible d’opérer une comparaison avec les dispositifs techniques qui ont été progressivement introduits et accumulés dans nos bâtiments, produisant un écosystème dont nous dépendons et qui, à partir d’un seuil critique, produit plus d’effets négatifs que positifs.
Lors de l’exploration de principes de conception bioclimatiques en phase de conception, nos partenaires — bureaux d’études et maîtrises d’ouvrage — nous opposent systématiquement un argument : il est impossible de quantifier les impacts de ces choix de conception avec certitude. En effet, les multiples variables en jeu (climat local, usage réel du bâtiment, comportements des occupant·es, interactions entre les matériaux) rendent toute prévision précise complexe. Il est notable de constater que le cadre même de la construction actuelle est fait de normes et de réglementations qui s’appuient sur l’équipement technique de nos bâtiments. Parce que ceux-ci semblent quantifiables avec plus d‘assurance, ils l’emportent sur toute autre solution.
On assiste alors à la généralisation d’une approche normative qui privilégie des bâtiments hautement étanches et fortement isolés, dont le climat intérieur est régulé par un arsenal technologique coordonné. Ce modèle repose sur une logique de contrôle total, où l’édifice est conçu comme une boîte hermétique, isolée de son environnement immédiat.
Cette mise à distance des aléas climatiques naturels n’est pas seulement une réponse aux exigences de confort ou d’efficacité énergétique, mais aussi une conséquence directe du besoin de quantification. En neutralisant les interactions avec le milieu extérieur et en encadrant strictement les conditions intérieures par des systèmes automatisés, on crée un cadre prédictible, compatible avec les méthodes de calcul et de simulation actuelles. Ce faisant, la complexité du vivant et des équilibres bioclimatiques est écartée au profit d’une approche où seule la maîtrise technique semble garantir la performance.
Malheureusement, le dérèglement climatique possède une propriété intrinsèque qui contrevient directement à cette mise à distance théorique : l’accident. La surchauffe, la panne, l’innondation, l’incendie, le gel, la tempête, le glissement de terrain, la sécheresse sont autant d’événements qui rappellent brutalement que le contrôle total est une illusion. Cette irruption — au sens propre d’entrée soudaine et violente d’éléments hostiles — accidentelle est l’enjeu majeur de la conception architecturale. Nous ne pouvons plus feindre de l’ignorer. Il est donc indispensable de déconstruire un grand nombre d’habitudes et de constructions sociales dans notre rapport au bâti, à sa conception, et à son usage, et particulièrement à la prééminence de la machine comme solution universelle.
McKenzie Wark, dans son article “De l’architecture à la kainotecture”4, écrit : “Toute l’architecture que nous connaissons est architecture de l’Holocène. L’architecture a dû faire face à de nombreux facteurs imprévisibles, mais le climat de l’Holocène a toujours été considéré comme une constante. […] Ce qui n’existe pas encore, c’est une façon de construire pour un climat qui sort des paramètres de l’Holocène”. Dans ce texte, McKenzie Wark met en évidence l’incertitude inhérente à l’entrée dans le climat de l’Anthropocène, et l’importance de concevoir des architectures capables de réagir à des conditions environnementales dont nous ne pouvons pas encore connaître l’intégralité des effets.
Face à cet argument sur l’impossibilité de quantifier les impacts et la réalité de la conception bioclimatique, nous avons entrepris la prise en main d’outils dédiés à la simulation thermique des bâtiments, au calcul d’empreinte carbone, et à la modélisation et l’analyse environnementale.
Explorer ces savoirs et méthodes de calcul implique non seulement une compréhension et une maîtrise des outils techniques de simulation, mais surtout une capacité à interroger les hypothèses qui sous-tendent leur fonctionnement. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler avec la suite d’outils de simulation libre et open source Ladybug Tools, qui permet une modularité d’usage indispensable à l’expérimentation de modèles non réglementaires.
À cette démarche, nous avons conjugué la lecture de documents d’archives issus de sources diverses — des traités d’architecture historiques aux rapports techniques récents, en passant par des articles académiques et des publications professionnelles. Cette exploration nous a permis de retracer l’évolution du rôle de l’architecte dans le dimensionnement des dispositifs techniques, depuis une approche globale intégrant la conception spatiale, climatique et matérielle, jusqu’à une délégation croissante de ces responsabilités à des bureaux d’études spécialisés.
Enfin, nous avons mené des campagnes de mesures sur des bâtiments récemment livrés, accompagnés d’entretiens auprès de leurs occupant·es, pour comprendre leur perception des systèmes techniques installés et leur usage réel.
Derrière ce processus de reprise des savoirs, nous restons lucides quant à l’inertie d’une industrie profondément enracinée dans des logiques activement opposées aux objectifs que nous formulons. Malgré la capacité de produire des études et des analyses démontrant la logique qui sous-tend des principes de construction sobres et low-techs, nos interlocuteur·ices resteront pour un temps encore attachés aux préjugés profondément ancrés dans des imaginaires modelés par la toute-puissance machinique.
Nous pensons qu’il est indispensable de partager ce savoir. C’est pourquoi nous choisissons de publier ici l’ensemble de nos hypothèses, méthodes et découvertes. Cette ressource permettra à chacun·e — architecte, étudiant·e, passionné·e — de s’emparer des outils que nous avons défriché. La constitution de cet ensemble documentaire francophone sera régulièrement mis à jour, à la fois par nos propres avancées, mais également par celles des potentiel·les contributeur·ices qui souhaiteraient y participer.
Keller Easterling écrit : “La bonne réponse n’est jamais définitive et sera inévitablement remise en question”5. C’est le principal renversement auquel nous devons travailler. Notre rôle d’architecte ne consiste pas à construire des situations fermées et achevées, mais à mettre en place “des spécifications pour des liens et des interdépendances qui restent en place pour s’équilibrer et se déséquilibrer mutuellement”6.
Footnotes
-
Bienert, Sven; Wein, Julia; Spanner, Maximilian; Kuhlwein, Hunter; Huber, Vanessa; Künzle, Chiara; Ulterino, Matthew; Carlin, David; Arshad, Maheen, Managing Transition Risk in Real Estate: Aligning to the Paris Climate Accord, 2022, Wörgl, Austria, p. 16. ↩
-
Ibid. ↩
-
Ivan ILLICH, Énergie et équité, 1973, Éditions du Seuil, p. 21. ↩
-
McKenzie WARK, Construire dans l’anthropocène : une architecture de l’accident ?, 2025 [2017], Revue Terrestres. ↩
-
Keller Easterling, Non vous ne l’êtes pas, 2024 [2016], lundimatin #455. ↩
-
Ibid. ↩